- Home
- Jim Fergus
Chrysis Page 9
Chrysis Read online
Page 9
À quelques variations près, la tenue préférée de Chrysis pour se promener dans le « village » et dessiner ou peindre dans son atelier était composée d’un large pantalon bouffant rayé vert pâle et violet, noué aux chevilles par des liens en soie, et d’un ample haut marron en maille chenille, avec des manches trois quarts. Par-dessus, elle enfilait une blouse smockée couleur mastic, récupérée auprès d’un fermier qu’elle avait rencontré sur le marché des halles un samedi matin, en échange d’un dessin qu’elle avait fait de son fils et de sa fille assis à l’arrière du camion familial. Cette vareuse, qu’elle portait ouverte, était pratique avec ses grandes poches dans lesquelles elle fourrait ses chiffons, petits pinceaux et crayons. Et pour compléter cet accoutrement plutôt éclectique, elle enroulait une longue écharpe en soie indonésienne autour de ses épais cheveux noirs et glissait ses pieds dans des babouches marocaines en cuir.
Le week-end précédant la reprise des cours à l’atelier, ses parents revinrent à Paris ; elle alla les chercher à la gare Montparnasse. Son père la détailla de haut en bas, constatant que ses craintes étaient fondées ; il était en train de perdre sa petite fille, les influences bohèmes du quartier déteignaient fortement sur elle.
« Ta mère t’emmènera faire les boutiques, dit le colonel, et t’achètera des vêtements corrects pour la rentrée.
– Cela me fait aussi plaisir de vous voir, père, fit-elle, en l’embrassant sur les deux joues.
– Je trouve que tu as bonne mine, ma chérie », dit sa mère, qui en secret enviait et admirait le tempérament indépendant de son artiste de fille.
S’agissant du nouveau nom que Chrysis avait adopté et qu’elle exigeait que tout le monde utilise désormais, le colonel Jungbluth, qui savait pertinemment quelle en était l’origine et comment elle en avait eu connaissance, aurait eu du mal à exprimer une objection véhémente. Pour des raisons évidentes, il ne souhaitait pas engager une discussion sur ce point avec son épouse et c’est ainsi que le père et la fille, même s’ils n’abordèrent jamais le sujet, gardèrent pour eux le secret du roman Aphrodite et de la courtisane Chrysis. Cependant, pas une seule fois, de toute sa vie, le colonel n’utiliserait ce nom pour s’adresser à sa fille.
IV
Les cours reprirent à l’atelier Humbert et, lorsque Chrysis ne s’y trouvait pas, elle travaillait dans son propre atelier. Elle était assidue, investie dans son art, mais le week-end, lorsque ses parents partaient dans leur maison à Rouen, elle saisissait l’occasion pour poursuivre ses explorations de la vie nocturne de Montparnasse. Au début, elle était restée surtout spectatrice, faisant la tournée des clubs et des cafés qui proliféraient toujours dans le quartier, se familiarisant avec les particularités et excentricités de chaque endroit, apprenant quel genre de clientèle, et qui, fréquentait quels lieux. Elle avait presque toujours sur elle son bloc à dessins, dont elle se servait comme d’une sorte de rempart pour repousser les avances qu’elle ne souhaitait pas, de la même manière que l’intimité des écrivains était souvent respectée lorsqu’on les voyait travailler, penchés sur leur carnet.
Chrysis était plus jeune que les artistes du quartier, mais à mesure que sa présence devenait plus familière, elle commença inévitablement à se faire des amis et des connaissances. Elle rencontra l’artiste Jules Pascin qui, comme elle, s’installait volontiers dans les cafés pour faire des esquisses et il était souvent vu en compagnie de l’une ou de plusieurs de ses modèles. Elle croisait régulièrement le photographe américain Man Ray, au Dôme ou à La Rotonde, presque toujours accompagné de celle que tout le monde appelait simplement Kiki, la modèle préférée des artistes, une femme superbe, gaie et très chic. Elle portait des tenues qu’elle créait elle-même et qui, souvent, dénudaient sa poitrine ; visiblement, elle avait ses convictions et elle les assumait. Parfois, Kiki arrivait au café enveloppée dans un manteau de fourrure, qui, par hasard, s’ouvrait une fois qu’elle était assise et révélait qu’elle était en dessous entièrement nue. Et elle expliquait cela par des contraintes pratiques : elle avait un rendez-vous pour poser et elle ne voulait pas que sa peau soit marquée par les élastiques des sous-vêtements.
Un jour, au Dôme, Chrysis rencontra l’amusant Japonais Foujita, avec sa frange, sa minuscule moustache et ses lunettes rondes cerclées d’écaille. Il lui demanda de venir dans son studio rue Delambre pour poser pour lui, mais elle refusa, comme à son habitude avec ce genre d’invitation. Chrysis connaissait son travail, après l’avoir vu exposé au Salon d’automne. Foujita était assez réputé dans le milieu parisien de l’art et, en avril de cette même année, il s’était vu décoré de la Légion d’honneur. En son for intérieur, elle se demandait ce que son succès devait à son excentricité et à son exotisme ; elle trouvait qu’il avait bien plus de talent pour se promouvoir que pour peindre.
Chrysis voyait souvent Picasso dans les rues ou dans l’un ou l’autre des cafés. Il était sans conteste le plus renommé des artistes et elle était bien trop intimidée pour lui parler. Mais, un jour, elle repéra Georges Braque à La Rotonde, elle l’approcha et se présenta comme une élève de son ancien maître, le professeur Humbert.
« Le vieux bonhomme sévit toujours, on dirait ? fit Braque. J’imagine qu’il est plus irascible que jamais. Vous savez, j’ai suivi son enseignement il y a plus de vingt ans. C’est un bon professeur et avec lui j’ai beaucoup appris. Mais nous nous sommes perdus de vue avec les années. Il a toléré ma période fauve mais je crains qu’il ne m’ait jamais pardonné mon cubisme.
– Oui, monsieur, je le sais, dit Chrysis. Il parle encore de vous en cours. Et malgré son dédain pour le cubisme, il vous tient en très haute estime.
– Je suis heureux de l’apprendre, jeune dame, dit Braque. Je vous remercie. Bonne chance à vous. Et transmettez mes salutations au professeur. »
Chrysis fit la connaissance de l’artiste russe Chaïm Soutine, qui avait, quelques années auparavant, étudié aussi dans l’un des ateliers de l’École des beaux-arts. Soutine paraissait être un homme simple, doux, et Chrysis admirait ses modestes tenues d’ouvrier, qu’il portait même lorsqu’il venait au café. Un jour, il l’invita dans son atelier rue Saint-Gothard pour lui montrer certaines de ses œuvres. Le peintre travaillait à ce moment-là sur une série d’études inspirées par Le Bœuf écorché, de Rembrandt, et Chrysis découvrit avec stupeur qu’il avait une carcasse entière accrochée au plafond de son local ; la charogne commençait à pourrir et dégageait une puanteur qui manqua la faire défaillir. « Vous voyez, jeune dame, dit Soutine en lui montrant la toile inachevée, posée sur son chevalet. Tel est le potentiel pouvoir de l’art ; il peut triompher de la putridité et même en être inspiré. Souvenez-vous bien, il n’y a pas de sujet qui soit hors de la portée de l’artiste, à partir du moment où il se sent engagé. »
Un autre jour, au Dôme, Chrysis rencontra l’artiste polonais Moïse Kisling qui, à son tour, la présenta à un de ses jeunes compatriotes, un poète gitan du nom de Casmir Luka, qui venait d’arriver à Paris. C’était un grand et beau jeune homme, à la peau mate et aux cheveux noirs bouclés, le visage sculpté par une mâchoire carrée et de hautes pommettes. Chrysis se sentit attirée par le gitan et elle lui demanda la permission de le dessiner. « Oui, vous pouvez me dessiner, si vous me permettez d’écrire un poème sur vous, dit-il. Et si vous m’offrez un bol de soupe, car je n’ai pas un sou. »
En plus des endroits populaires autour du carrefour Vavin, Chrysis commença à fréquenter certains lieux nocturnes plus petits, plus intimes, en particulier ceux qui offraient de la musique et où l’on pouvait danser, comme Le Jockey, La Cigogne, Le Parnasse, La Jungle, et, surtout, Le Bal nègre, un club minuscule en retrait de la rue Blomet, où se retrouvaient des travailleurs immigrés originaires des Antilles pour écouter des orchestres de jazz nègres. Chrysis adorait danser, adorait le jazz et le blues, et elle apprit tous les nouveaux pas introduits à Paris par les nombreux Américains venus après la guerre. Elle aimait les musiciens noirs et, dans les clubs, ell
e dansait aussi bien avec les hommes qu’avec les femmes, selon la personne qui l’invitait en premier, peu lui importait, du moment qu’elle dansait, qu’elle ne restait pas assise, qu’elle pouvait dépenser son inépuisable énergie. Parfois, lorsqu’une femme la tenait dans ses bras et que leurs corps se touchaient au rythme sensuel de la musique, Chrysis ressentait des frissons qui lui étaient inconnus. Cela ne la dérangeait en rien et elle n’essaya pas de refouler ces sensations ; au contraire, elle était intriguée par ce désir nouveau qui se manifestait en elle. Elle était jeune, vivante, réceptive à toutes les stimulations, elle ne faisait pas de distinction entre l’art et la vie, qu’elle embrassait avec un appétit insatiable.
Chrysis traversait parfois la Seine pour rejoindre la rive droite et aller au Bœuf sur le toit, qui avait la plus grande piste de danse et parfois les meilleurs orchestres de jazz de la ville. Là, elle vit souvent l’illustre dramaturge Jean Cocteau entouré de sa cour. Kiki s’y produisait parfois en s’accompagnant au piano ; elle avait une voix épouvantable, mais une vivacité contagieuse lorsqu’elle parlait ou chantait, et généralement à moitié ivre, elle gratifiait le public de chansons paillardes qui le charmaient et l’émoustillaient. Le bar était décoré de tableaux surréalistes de Picabia, que Chrysis n’affectionnait pas particulièrement. Mais elle n’avait pas connu la guerre et elle n’était pas encore assez âgée ni assez expérimentée pour tomber dans le cynisme ou apprécier la déconstruction. Le monde lui paraissait encore merveilleux, riche d’aventures, de promesses et d’espoirs infinis, plein de couleurs, de sensualité, de lumière et de rires, et c’était cela qu’elle voulait saisir dans ses peintures.
En dehors des artistes de l’establishment, plus âgés, le « village » était fréquenté, dans ces années-là, par des douzaines, des centaines, des milliers de jeunes aspirants romanciers, poètes, peintres, sculpteurs, modèles, étudiants et autres parasites, de toutes races et de toutes nationalités, dont la grande majorité ne seraient jamais connus dans leur domaine et dont on n’entendrait jamais parler. Mais, dans ce bref moment de grâce particulier à la jeunesse, personne ne pouvait encore le savoir, et pour Chrysis elle-même, comme pour ceux qui de fait s’efforçaient de progresser dans leur art, tout paraissait encore possible, les rêves n’étaient pas encore anéantis par la marche inexorable du temps et de la réalité.
V
À l’automne de cette année-là, un nouveau café, Le Select, ouvrit ses portes au coin du boulevard Montparnasse et de la rue Vavin. Immédiatement, il eut la faveur des écrivains et des peintres du « village », qui furent nombreux à délaisser La Rotonde et le Dôme pour en faire leur nouveau lieu de prédilection.
Un froid après-midi humide, à la mi-novembre, par les rues jonchées de feuilles mortes détrempées, alors que tombait une bruine décourageante, Chrysis s’approcha du Select. En proie à une vague mélancolie de saison, elle regarda à travers la vitre un peu embuée, entre les coulures provoquées par la condensation sur le verre chauffé de l’intérieur. C’était un jour où elle aurait été heureuse d’avoir un peu de compagnie et elle se mit à chercher un visage connu parmi les clients du café.
Elle vit un homme assis seul à une table contre le mur, écrivant dans un carnet ; à cet instant précis, il leva la tête. Ils échangèrent un regard, lui dans la chaleur du café, elle sur le trottoir froid et mouillé. Il était apparemment concentré sur ce qu’il était en train d’écrire ; bien qu’il parût la regarder droit dans les yeux, son regard sembla la traverser de part en part, comme si elle était invisible ou transparente. Pourtant, dans la brièveté de cet échange, Chrysis se dit qu’elle était tombée amoureuse. Elle n’avait jamais vu auparavant des yeux aussi extraordinaires – noirs, doux, tristes, habités ; sa gorge se serra au point de bloquer sa respiration et elle eut l’étrange sensation de perdre l’équilibre. Elle rougit et détourna le regard, alla jusqu’à la porte et entra, avant d’enlever son écharpe et son manteau, sous lequel elle cachait, à l’abri de la neige, son bloc à dessins. Elle suspendit son manteau à la patère à côté de la porte, choisit une table à l’opposé de celle de l’homme, ouvrit son bloc et, discrètement, se mit à le dessiner.
De temps en temps, il marquait un temps d’arrêt dans son activité d’écriture et levait la tête, pensif, comme s’il réfléchissait à un mot, une tournure de phrase, avant de retourner à son texte. C’était curieux, cette façon qu’il avait d’être complètement isolé, indépendant, comme s’il existait uniquement en lui-même, comme s’il n’était pas tout à fait connecté au monde extérieur, sauf dans ces brefs moments où ses yeux trahissaient une douleur cachée. Chrysis se dit que, si elle réussissait à saisir l’émotion subtile que ces yeux exprimaient, elle serait une véritable artiste.
L’homme avait les cheveux noirs, des traits forts, et même assis, on voyait bien qu’il était grand et élancé. Tout en dessinant, elle remarqua aussi qu’il avait de belles mains aux contours puissants, les mains d’un homme qui avait une activité physique, et en les esquissant sur sa feuille, elle sentit monter son excitation à l’idée de leurs caresses sur son corps.
Alors qu’elle finissait son dessin, Chrysis jeta un coup d’œil sur le visage de l’homme qui écrivait et elle crut voir des larmes perler au coin de ses yeux. Elle détourna rapidement le regard, gênée d’avoir surpris ce moment d’une telle intimité. Elle termina son dessin et posa son bloc sur la table ; presque au même moment, l’homme referma son carnet. Il plongea la main dans sa poche, en sortit un peu de monnaie, regarda la note et déposa quelques pièces dans la soucoupe. Il se leva. Elle vit qu’il portait des bottes de cow-boy et un Levi’s. Les cow-boys et les Indiens faisaient fureur à cette époque à Montparnasse, surtout dans les bals où tout le monde se déguisait pour prétendre être quelqu’un d’autre, mais elle ne pensait pas que ces vêtements soient une affectation de la part de cet homme, ni un déguisement.
Lorsqu’il marcha jusqu’au portemanteau installé à côté de la porte, il passa devant sa table sans lui accorder un regard et Chrysis dit : « Excusez-moi, monsieur, je viens de vous dessiner. Voudriez-vous voir le résultat ? »
L’homme s’arrêta, se tourna et la regarda sans ciller, de ses yeux saisissants. On aurait dit qu’il la voyait pour la première fois, qu’il n’avait pas vraiment compris ce qu’elle venait de lui dire, ou qu’il était surpris qu’on s’adresse à lui de cette manière. Chrysis se sentit rougir. « Je vous prie de m’excuser de vous avoir dérangé, monsieur », dit-elle, déroutée par l’étrange pouvoir de son regard, qui paraissait posséder une sorte d’omniscience douloureuse, comme si c’était son âme blessée qui venait toucher la sienne. Tout à coup, son assurance avait disparu et elle se sentit aussi idiote qu’une écolière. « Je… je pensais juste que cela vous ferait peut-être plaisir de voir le dessin que j’ai fait de vous pendant que vous travailliez. Puis-je… vous le montrer ? »
L’homme continua à la fixer de ses yeux noirs, son regard perça la poitrine de Chrysis, dénuda son cœur battant, exposa ses peurs et ses désirs les plus secrets qui semblèrent s’étaler sur le sol du café comme une flaque de sang. Pour finir, il hocha la tête. « Non, non, merci », dit-il. Il alla jusqu’à la porte, prit un long manteau en toile, l’enfila, remonta le col bien haut autour de son cou ; il saisit un chapeau de cow-boy sur un crochet, le posa sur sa tête et, sans regarder derrière lui, poussa la porte et disparut dans la pénombre du crépuscule d’hiver.
Chrysis le regarda s’éloigner, le cœur battant la chamade, tout son corps en émoi, embrasé. Ce n’est que plus tard qu’elle se rendit compte qu’elle ne savait même pas comment il s’appelait, ni si elle le reverrait un jour.
VI
Chrysis quitta le Select et descendit la rue jusqu’au Dôme, où elle savait qu’elle trouverait son ami Casmir, le poète gitan, à qui Kisling l’avait présentée. Casmir était très pauvre et portait des vêtements raccommodés et des chaussures trouées ; chaque fois qu’elle le voyait, il avait l’air plus miteux. Elle ne savait pas s
’il était un bon poète, mais il paraissait gentil et doux, et elle s’inquiétait de ses chances de survivre à Paris.
« Est-ce que je peux m’asseoir avec toi, Casmir ? demanda-t-elle.
– Bien sûr, Chrysis. M’offrirais-tu un bol de soupe ?
– Oui, ce que tu veux. Je suis venue te trouver parce que je voudrais te demander un service très personnel.
– Eh bien, je t’écoute.
– Je crois que je suis tombée amoureuse.
– Quand ?
– Là, maintenant.
– De moi ?
– Non, pas de toi, dit Chrysis avec un gentil sourire. Mais je veux que tu me ramènes chez toi. Une fois que tu auras mangé ta soupe, je voudrais que tu m’emmènes chez toi et que tu m’apprennes ce qu’est l’amour. »
Il fallait moins de cinq minutes à pied pour aller du Dôme jusqu’au logement du poète, une misérable mansarde au coin de la rue de Chevreuse. Ils marchèrent vite et sans parler. Ils montèrent le sinistre escalier jusqu’au dernier étage et Casmir ouvrit la porte avec sa clé. « Ce n’est pas grand-chose, dit-il en s’excusant, mais je n’ai pas beaucoup de moyens. »
Effectivement, c’était tout petit, mais Chrysis s’en fichait.
« Assieds-toi, je t’en prie », dit-il en désignant une chaise branlante en bois à côté de la petite table de cuisine, qui était couverte de morceaux de papier sur lesquels étaient notés des poèmes ou des fragments de poèmes. Elle n’enleva pas son manteau, il faisait froid dans la chambre.
Casmir fourra du papier et des bâtons dans un poêle en fonte et y jeta une allumette enflammée.
« Le bois de chauffage est tellement cher, dit-il. Kisling m’en a donné un peu.
– Est-ce que tu écris tous tes poèmes en polonais, ou écris-tu aussi en français ? demanda Chrysis.

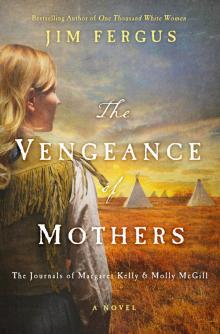 La Vengeance des mères
La Vengeance des mères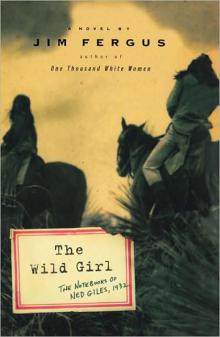 The Wild Girl: The Notebooks of Ned Giles, 1932
The Wild Girl: The Notebooks of Ned Giles, 1932 One Thousand White Women
One Thousand White Women One Thousand White Women: The Journals of May Dodd
One Thousand White Women: The Journals of May Dodd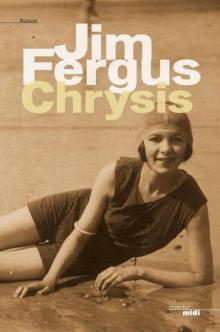 Chrysis
Chrysis Strongheart: The Lost Journals of May Dodd and Molly McGill
Strongheart: The Lost Journals of May Dodd and Molly McGill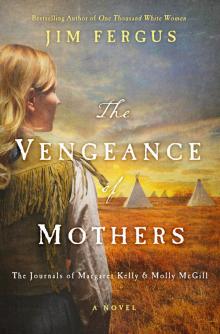 The Vengeance of Mothers
The Vengeance of Mothers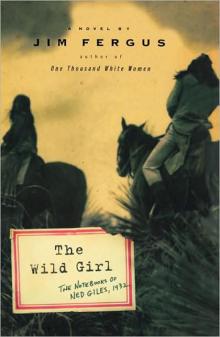 The Wild Girl
The Wild Girl