- Home
- Jim Fergus
Chrysis Page 3
Chrysis Read online
Page 3
– Sincèrement, j’en serais heureux. Un salaire serait le bienvenu, dans l’attente d’un navire. Et quel genre d’emploi offrez-vous, si vous me permettez de vous le demander, madame ?
– Nous avons récemment perdu notre videur, dit Mona. Un grand Roumain, peut-être l’avez-vous vu par ici ; il se faisait appeler Vlad. Il nous a quittées sans préavis pour se faire embaucher sur un bateau en partance pour le Brésil. Vous êtes un voisin proche et vous avez certainement remarqué que l’ambiance peut parfois tourner au chahut. Il nous est indispensable d’avoir un homme fort sur place pour faire respecter les règles.
– Et quelles sont-elles, Mona ? demanda Bogey.
– Sont interdits : les bagarres, les insultes, les vomissements et, surtout, il est interdit de faire du mal aux filles, dit Mona. Il est vrai que vous n’êtes physiquement pas aussi impressionnant que Vlad et que votre nom n’est pas aussi intimidant. Néanmoins, votre personnage de cow-boy jouera en votre faveur et vous êtes un grand gars, on dirait bien que vous êtes capable de vous tirer d’affaire en cas de difficulté. Est-ce une place que vous pensez pouvoir occuper, jeune Bogart ?
– Eh bien, oui, madame, je crois que je pourrais faire ce travail. J’ai une certaine expérience de la boxe et j’ai un six-coups avec lequel je suis assez habile, si vous me permettez de me vanter ainsi.
– La boxe est un atout utile, je le reconnais, dit Mona, qui fit passer les assiettes garnies autour de la table, mais nous évitons le recours aux armes à feu. Face aux clients récalcitrants, l’approche privilégiée par Vlad consistait à leur arracher un morceau d’oreille, ce qui avait un effet dissuasif efficace en cas de comportements violents, mais c’était assez salissant.
« En ce qui concerne votre rémunération, elle se composera de trois parties, si cela vous convient. D’abord, je vous fournis le logement, autrement dit, vous pouvez quitter la pension et vous installer dans votre chambre ici dès que vous voudrez. Ensuite, vous recevrez un salaire en liquide payable tous les dimanches ; nous en discuterons en tête à tête et en détail, dans mon bureau. Et troisième point, dit Mona en balayant la table d’un grand geste de la main, selon votre choix et pour votre plaisir, vous pouvez profiter des services de mes exceptionnelles employées ici présentes – en dehors des heures de travail, bien sûr, et avec leur consentement. »
En entendant cela, Bogey piqua un fard et les filles se moquèrent de sa gêne en riant aux éclats.
« Cela vous paraît-il un arrangement satisfaisant, Bogart ? demanda Mona.
– Eh bien… oui, madame… oui, Mona, certainement, bafouilla Bogey, ce qui déclencha de nouveaux gloussements. Cela me paraît tout à fait satisfaisant. »
IV
Les jours, les semaines passèrent et aucun navire venant de France ne jeta l’ancre dans le port. La chaleur de l’été urbain fit place à une fraîcheur automnale et, à la mi-octobre, les arbres de la côte est étaient parés de couleurs flamboyantes.
Bogey était confortablement installé chez Mona et, en dehors des horaires tardifs et des interactions quotidiennes avec des matelots ivres et agressifs, il s’y sentait vraiment heureux. Le travail n’était pas difficile ; il mettait régulièrement fin à des bagarres et, parfois, il devait lui-même se battre, mais comme il était un boxeur chevronné et que ses adversaires étaient presque toujours en état d’ivresse lorsqu’il avait affaire à eux, ces bagarres tournaient rapidement court, la supériorité était toujours du même côté. Et dans le cas extrême où les poings de Bogey ne suffisaient pas à venir à bout d’un marin particulièrement rétif, Mona lui avait donné une matraque de policier en noyer, ce qui lui permettait de régler le sort des clients les plus violents.
Le « videur cow-boy », comme on en vint à appeler Bogey dans le port, eut bientôt la réputation bien établie d’un homme qu’il valait mieux prendre au sérieux et, petit à petit, le comportement de la clientèle s’améliora. Bogey se montrait protecteur à l’égard de ses filles et la sanction physique de loin la plus sévère, il la réservait à ceux qui les maltraitaient, d’une façon ou d’une autre. Il avait été bien élevé par sa mère et, pour lui, la femme était sacrée. En retour, les filles se prirent d’amitié pour le jeune cow-boy, qui était si différent de leurs clients habituels, et souvent elles désiraient vivement lui témoigner leur gratitude.
C’est ainsi que Bogey profita pleinement des faveurs du personnel de Mona – le complément de son salaire – et se livra sans retenue aux plaisirs érotiques d’une vie parfaitement hédoniste, qui, de plus, était amusante et très gaie.
Comme Bogey avait grandi dans un ranch, il s’était, toute sa vie, levé à l’aube, voire plus tôt ; désormais, à cause de ses obligations qui se prolongeaient jusqu’au petit matin, il se réveillait rarement avant midi, les bras et les jambes parfois emmêlés avec ceux de deux ou trois filles endormies dans son lit, tout ce petit monde assoupi comme une portée de chiots collés les uns aux autres. Il lui arrivait de faire l’amour avec une ou deux d’entre elles, celles qui étaient réveillées – de partager leurs caresses lascives et douces du matin ; à peine sorti du sommeil, il se délectait de leur peau chaude et moite. Parfois, ils se rendormaient tous.
Bogey devint, en plus d’un amant, un ami pour ces filles, une sorte de confident avec qui elles partageaient leurs rêves d’avenir, dans lesquels il n’était plus question de marins ivres venant les sauter, année après année. Bogey écoutait leurs histoires, qu’il consignait dans son carnet. Ces jeunes femmes avaient les mêmes espoirs et les mêmes aspirations que toutes les autres, bien qu’elles vinssent presque toujours de milieux difficiles, où elles avaient connu la pauvreté, les drames familiaux, les parents alcooliques, les pères violents – toutes sortes de maux dont Bogey ne savait absolument rien, étant donné sa propre expérience de la vie. Certaines espéraient une famille, un mari, des enfants, la sécurité, d’autres rêvaient simplement d’une vie de voyages et d’aventures, même si la réalisation de ces projets n’était formulée qu’en termes très vagues. De temps en temps, une fille quittait l’établissement de Mona, pour prendre un autre emploi en ville, ou sur un bateau, et plus rarement, il arrivait que l’une d’elles s’enfuie avec un jeune marin au visage juvénile qui était tombé amoureux d’elle. Le plus souvent, on n’avait plus jamais de nouvelles ; parfois, elle revenait, la tête basse, douce comme un agneau, et reprenait son ancien emploi.
Bogey entretenait une relation particulière avec Lola, la fille de Mona, que sa mère formait pour qu’elle reprenne l’affaire familiale. Comme Lola appartenait au personnel « de direction » et n’avait donc pas le même statut que les autres filles, Mona avait d’emblée expliqué clairement à Bogey que sa fille n’était pas incluse dans l’offre qui supplémentait son salaire. La politique qu’il se devait de suivre dans son cas était la stricte non-intervention. Néanmoins, Mona avait fini par apprécier Bogey et, lorsqu’elle constata qu’un début d’idylle se nouait entre eux, elle ne le découragea pas. Par respect pour sa patronne, Bogey tint à ce que sa relation avec Lola reste chaste, bien que la jeune fille fût au courant, bien entendu, de ses ébats sexuels avec les autres filles.
Le dimanche, le seul jour de la semaine où les portes de chez Mona étaient closes, Bogey louait un second cheval aux écuries et Lola et lui partaient en promenade. Ils emportaient souvent un pique-nique. La campagne était encore peu éloignée du port sale et populeux, et lorsque Bogey avait un jour de congé, il ressentait toujours le besoin de se replonger dans la nature, de retrouver un peu d’espace et de verdure ; se rapprocher à nouveau de la terre, s’éloigner du béton et des briques lui était essentiel, et il en était de même pour Crazy Horse.
Au cours de ces promenades, Bogey décrivait à Lola sa vie dans le Colorado, les montagnes et les plaines, les rivières et les torrents, la nature sauvage, les saisons au ranch et sa famille. Lola écoutait ses récits avec ravissement, sans pouvoir imaginer un espace aussi vaste, aussi vierge, et une vie si différente de la sienne. « J’aimerais vraiment voir ça un jour, murm
urait-elle. Qu’est-ce qui a bien pu te pousser à quitter un endroit pareil pour venir ici ? On dirait pourtant que c’est le paradis. » C’était une fille bien, Lola, et Bogey se dit qu’il était peut-être en train de tomber un petit peu amoureux d’elle.
V
Finalement, un après-midi de fin octobre, un navire venant de France, le Rochambeau, entra au port. Bogey descendit immédiatement à la capitainerie, où on lui donna le nom du commissaire de bord, un certain M. Joubert, qui avait la responsabilité des embauches.
Quand il arriva au poste d’amarrage, Bogey fut conduit par un membre d’équipage sur la passerelle, jusqu’au bureau du commissaire de bord. « Asseyez-vous, jeune homme », dit M. Joubert sans bouger de son bureau, en lui désignant une chaise. C’était un petit homme propret et élégant, aux cheveux gominés, vêtu d’un costume sombre ajusté et dont la lèvre supérieure était ourlée d’une fine moustache.
« Je présume que vous êtes venu pour vous faire embaucher dans l’équipage ?
– Oui, monsieur. Je viens de l’État du Colorado, dit Bogey, et je vais en France rejoindre la Légion étrangère et combattre les méchants Huns. »
En entendant cela, M. Joubert leva un sourcil et nota d’une écriture minuscule très chic quelque chose sur son cahier. Le commissaire de bord avait des petites mains manucurées et, dans ses gestes, la précision d’un bureaucrate chevronné.
« Je vois… dit-il. Mais le Colorado est à une grande distance de la côte, n’est-ce pas ?
– Oui, monsieur, c’est effectivement très loin.
– Et quelle expérience avez-vous du travail sur les navires-cargos, jeune homme ?
– Aucune, monsieur. Mais je suis travailleur et j’apprends vite.
– Êtes-vous jamais monté sur un bateau auparavant ? » demanda le commissaire de bord.
Bogey jeta un coup d’œil à la cabine dans laquelle il se trouvait.
« Non, monsieur, je ne peux pas dire que c’est le cas. C’est la toute première fois. Et je dois ajouter, monsieur, que j’ai un cheval qui doit traverser l’océan parce que j’ai l’intention de rejoindre le régiment de cavalerie de la Légion étrangère.
– Jeune homme, je ne tiens pas à vous décevoir, fit M. Joubert, mais la Légion étrangère n’a pas de cavalerie, seulement des régiments d’infanterie.
– Mais c’est impossible, dit Bogey. Chez moi, j’ai vu des photographies de la cavalerie française dans des magazines.
– C’était probablement des régiments de cavalerie de l’armée française, jeune homme, pas de la Légion étrangère.
– Eh bien, il me suffira alors de rejoindre les rangs de l’armée française.
– C’est un droit réservé aux Français, je le crains, dit M. Joubert. D’où, précisément, la création de la Légion, pour permettre à des citoyens de pays alliés de combattre à nos côtés.
– Mais je ne veux pas être fantassin, dit Bogey. Savez-vous ce qu’on dit, chez moi, à propos des cow-boys qui se retrouvent à pied, n’est-ce pas ?
– Ah, non, je suis certain de ne pas connaître la réponse à cette question, jeune homme.
– On dit : “Si tu es à pied, c’est que tu n’es pas un vrai cow-boy.”
– Ceci étant dit, reprit M. Joubert, souhaitez-vous toujours transporter votre cheval en France ?
– Je ne peux pas vraiment le laisser ici, ne croyez-vous pas ? répondit Bogey. Et il est trop tard maintenant pour que je le renvoie à la maison. Je n’aurai plus qu’à trouver en France un endroit où le mettre en pension. »
M. Joubert s’éclaircit la voix.
« Revenons à l’entretien qui nous occupe, jeune homme. Savez-vous nager ?
– Non, monsieur.
– Comme vous n’avez aucune expérience préalable en mer, quelle fonction utile pensez-vous être capable d’assumer sur le navire ?
– Je sais réparer des choses, monsieur, proposa Bogey. Je sais me servir d’outils. Je sais démonter un tracteur et le remonter complètement.
– Réparer des tracteurs n’est pas une compétence particulièrement utile sur un cargo, fit remarquer le commissaire de bord.
– Non, monsieur, j’imagine bien que non, mais si vous aviez des soucis de moteur en route, je pourrais peut-être vous aider.
– Mais, voyez-vous, nous avons des ingénieurs à bord qui sont chargés de ce genre de tâches. Et comment pourrais-je même être certain que vous ne serez pas sujet au mal de mer, puisque vous n’avez jamais mis le pied sur un navire ? À cette époque de l’année, la mer est souvent forte, ce qui peut donner lieu à des épisodes très mouvementés. C’est arrivé dans le passé : certains marins inexpérimentés ont passé l’essentiel du voyage à vomir dans des seaux, ce qui a nui gravement à leur efficacité en tant que membres d’équipage.
– Monsieur, chez moi, je monte des broncos déchaînés dans les rodéos, dit Bogey. Croyez-moi, on peut parler d’épisodes mouvementés… Je me suis fait déculasser de nombreuses fois, mais pas une fois je n’ai rendu mes cookies. »
M. Joubert n’était pas complètement certain de savoir ce qu’était un « bronco » et n’avait pas la moindre idée du sens de « déculasser » ou de « rendre ses cookies ». Néanmoins, derrière la froide posture bureaucratique du commissaire de bord se cachait un romantique dans la plus pure tradition française, doté d’un sens patriotique qui éveillait en lui une secrète admiration pour cet audacieux cow-boy venu du Colorado avec ce rêve fou d’emmener son cheval jusqu’en France pour combattre l’envahisseur allemand. De plus, d’un point de vue plus pratique et moins altruiste, l’ordre qui lui avait été donné par les propriétaires du navire était de payer les membres d’équipage le moins possible, ou mieux encore, de ne leur donner rien du tout.
Pendant un moment, M. Joubert tapota nerveusement son cahier du bout de son crayon. « Jeune homme, finit-il par dire, avec un hochement de tête, je pense effectivement que je pourrai peut-être trouver de la place sur le Rochambeau, pour vous et votre cheval. Cependant, comme vous n’avez pas la moindre expérience en mer, ni de compétence évidente qui pourrait être utile sur le bateau, je ne vous propose que la traversée – couchette et nourriture, autrement dit – pour laquelle vous devrez travailler, sans percevoir de salaire, en vous acquittant de toutes les tâches, si ingrates soient-elles, que le capitaine et les membres d’équipage vous imposeront. En résumé, vous occuperez, à bord, la position hiérarchique la plus basse. En même temps, il vous incombera de prévoir, à fond de cale, une enceinte adéquate pour contenir votre cheval de manière sûre et suffisamment de fourrage pour nourrir ledit animal durant toute la traversée ; selon les conditions météorologiques et la charge définitive de notre cargaison, celle-ci pourra varier de dix à quatorze jours. Étant donné le danger représenté par les sous-marins allemands, nous ne pouvons plus accoster au Havre, mais nous devons aller plus au sud, à Bordeaux, ce qui allonge d’autant le voyage, sans diminuer les risques. Comprenez-vous ? Êtes-vous prêt à accepter ces conditions ?
– Oui, monsieur Joubert, répondit Bogey. Je comprends parfaitement. Je les accepte toutes. Je travaillerai dur pour vous et je ne décevrai personne, ni vous, ni le capitaine, ni l’équipage. Vous verrez, monsieur. Merci, monsieur. »
Trois semaines plus tard, pendant la dernière nuit que Bogey passait chez Mona, Lola vint le retrouver dans sa chambre ; elle enleva ses vêtements et s’allongea contre lui. Elle chuchota : « Je veux que le dernier souvenir que tu emportes de cet endroit, ce ne soit pas celui d’une nuit avec une des filles, ou avec plusieurs, comme tu sembles le préférer. Je veux que ce dernier souvenir, ce soit moi. Je voudrais que tu emportes mon odeur sur ce navire, de l’autre côté de l’océan, jusqu’à la France. Je sais que je n’aurai jamais la chance d’y aller moi-même. Est-ce que tu comprends ? »
Bogey hocha la tête. Il prit doucement son menton dans sa main. Lola était une jeune femme pâle, aux cheveux clairs ; sa peau douce sentait le parfum des feuilles roussies de l’automne et, lorsqu’ils firent l’amour, ce fut di
fférent de ce que Bogey partageait avec les autres filles, pour qui il n’éprouvait pas de sentiments. Il caressa ses petits seins, qui ressemblaient à ceux d’une fillette, il embrassa ses tétons durcis. Tous les deux savaient que c’était à la fois le début et la fin de quelque chose, et qu’après cette nuit-là ils ne se reverraient probablement jamais.
Le Rochambeau largua les amarres à l’aube du 5 novembre 1916 ; c’était un matin gris et froid, une neige légère tombait sur la ville de New York. Lorsque les câbles des remorqueurs furent détachés et que le navire atteignit la haute mer, Bogey remonta des ponts inférieurs, où il avait déjà été mis au travail – à récurer les toilettes de l’équipage. Il se tint au bastingage et contempla la mer et le ciel monochromes, qui paraissaient se fondre, comme s’il n’y avait plus d’horizon. Et Bogey se dit que ce vaste océan uniforme était vraiment la contrée la plus solitaire qu’il ait jamais vue de toute sa vie.
GABRIELLE
1918-1925
I
Un matin clair et froid de janvier 1925, Gabrielle Jungbluth, 18 ans, partit à pied du foyer de jeunes filles situé rue Denfert-Rochereau à Montparnasse, pour se rendre à ses premiers cours d’art à l’atelier Humbert, dans la prestigieuse École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Gabrielle était une grande et belle jeune fille, aux longues jambes et à la silhouette gracieuse ; ses longs cheveux noirs étaient remontés en chignon sous son bonnet en laine, et elle avait de grands yeux expressifs qui étaient particulièrement brillants, ce jour-là. Dans l’air glacial du matin, son souffle dessinait des petites volutes ; elle marchait d’un bon pas, avec une assurance naturelle qui la faisait paraître plus âgée. Ses longues et légères enjambées révélaient toute la confiance triomphante d’une jeune artiste précoce, décidée à se faire une place dans le monde de l’art.

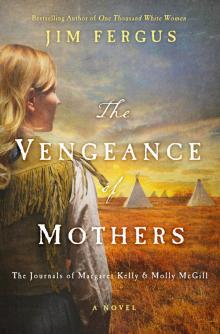 La Vengeance des mères
La Vengeance des mères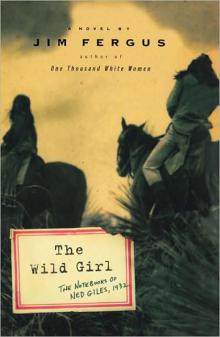 The Wild Girl: The Notebooks of Ned Giles, 1932
The Wild Girl: The Notebooks of Ned Giles, 1932 One Thousand White Women
One Thousand White Women One Thousand White Women: The Journals of May Dodd
One Thousand White Women: The Journals of May Dodd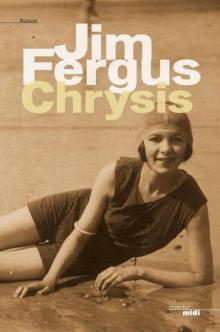 Chrysis
Chrysis Strongheart: The Lost Journals of May Dodd and Molly McGill
Strongheart: The Lost Journals of May Dodd and Molly McGill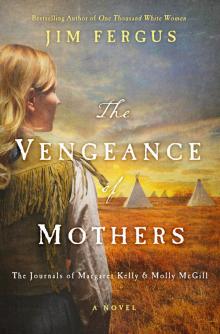 The Vengeance of Mothers
The Vengeance of Mothers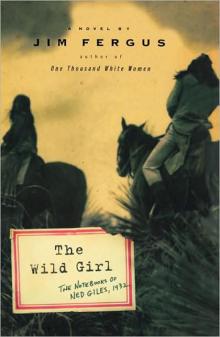 The Wild Girl
The Wild Girl